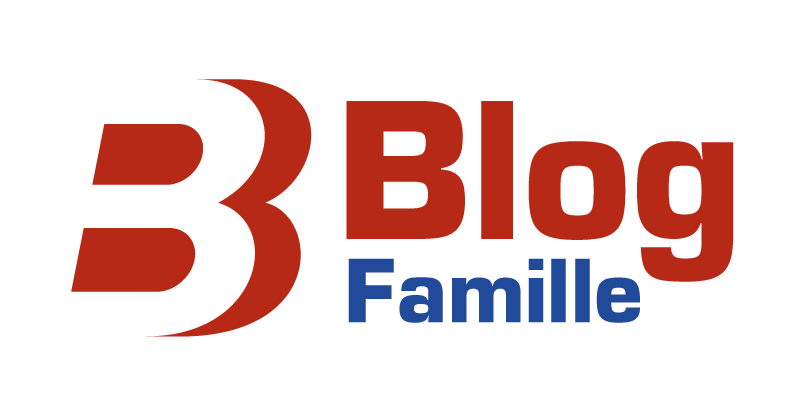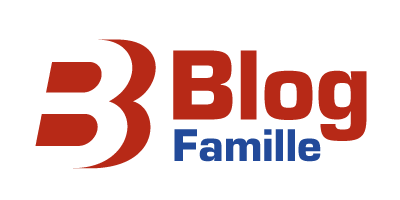Un enfant de 18 mois qui ne marche pas encore n’est pas systématiquement en situation de retard pathologique. Certains atteignent cette étape bien après leur premier anniversaire sans que cela n’indique un problème de santé. Pourtant, des signes spécifiques peuvent signaler un trouble du développement moteur.
Des recommandations officielles existent pour guider la surveillance du développement locomoteur. Les parents sont souvent confrontés à des avis divergents, entre inquiétudes légitimes et diversité du rythme individuel. Des repères clairs et des conseils adaptés permettent de mieux accompagner chaque étape et d’identifier, si besoin, le moment opportun pour consulter.
Comprendre le rythme naturel de l’apprentissage de la marche
Chaque enfant avance à sa cadence. La marche ne s’impose pas à une date fixe, mais s’inscrit dans une progression qui mobilise autant le développement moteur que la maturité psychique et l’environnement familial. Entre 9 et 18 mois, la plupart des bébés tentent leurs premiers pas, mais chaque parcours reste unique. Certains préfèrent explorer longuement le quatre-pattes, d’autres se concentrent sur l’équilibre en position debout avant de se lancer.
Avant de marcher, chaque enfant franchit plusieurs paliers : s’asseoir sans aide, se retourner, puis se hisser debout. Ces étapes du développement moteur ne s’enchaînent pas toujours dans le même ordre ni au même rythme. Le rôle des proches ? Offrir un espace sûr et stimulant, laisser le temps à l’exploration, éviter de forcer la main.
Voici les principales étapes qu’on observe fréquemment dans l’acquisition de la marche :
- Vers 6-8 mois : maîtrise de la position assise sans appui
- Autour de 9-12 mois : déplacement à quatre pattes ou en rampant
- Entre 10 et 16 mois : passage à la station debout avec appui
- De 12 à 18 mois : premiers pas sans aide
Le rythme d’acquisition de la marche dépend aussi de l’hérédité et des habitudes familiales. L’observation est la règle : chaque enfant combine à sa façon prudence, curiosité et besoin d’agir. Il est inutile de comparer les frères et sœurs ou de s’angoisser en cas de décalage. Les soignants se fient à la dynamique globale du développement moteur plutôt qu’à des seuils calendaires. Mieux vaut surveiller, accompagner, que précipiter les choses.
À quel moment faut-il s’interroger sur un éventuel retard ?
Le retard de la marche interroge souvent les familles. Si un enfant n’a pas encore marché à 18 mois passés, il convient d’examiner la situation dans son ensemble. Avant d’imaginer une pathologie, un coup d’œil sur les antécédents familiaux s’impose : certaines lignées ont simplement un rythme plus lent, sans que cela signale un trouble. Pourtant, certains signes méritent une vigilance accrue.
L’ensemble du développement moteur doit être observé. Un enfant qui ne tente pas de se mettre debout, ne rampe pas ou semble rester à l’écart des acquisitions motrices classiques mérite une attention particulière. Le carnet de santé permet de vérifier la cohérence de la chronologie. Lorsqu’on repère des écarts marqués, ou l’association à d’autres difficultés (tonus, posture, appui absent sur les jambes), il s’agit de ne pas attendre pour consulter un professionnel.
Voici les situations qui demandent une attention particulière :
- Absence de station debout avec appui après 12-15 mois
- Pas de déplacement autonome (ramper ou quatre pattes) à l’approche des 15 mois
- Désintérêt marqué pour l’exploration ou la mobilité
Si l’enfant ne marche pas à 18 mois, ou plus tôt en cas de doute, il est temps de consulter un professionnel de santé : pédiatre ou médecin généraliste. L’analyse clinique, l’échange autour des antécédents, et parfois des examens complémentaires, permettent d’affiner le diagnostic. Les conditions de vie, le contexte (manque de stimulation, confinement) doivent être pris en compte, mais il ne faut pas négliger le caractère singulier de chaque développement.
Signes à observer : ce qui doit rassurer, ce qui peut alerter
Distinguer un rythme individuel d’un vrai retard d’acquisition n’est pas toujours évident. Certains enfants prennent leur temps, puis progressent soudainement. Ce qui compte, c’est la dynamique : un enfant qui teste, qui évolue, qui explore autrement (ramper, quatre pattes) et manifeste de l’intérêt pour son environnement transmet des signes rassurants. Les progrès sont parfois subtils : une tentative d’appui, quelques pas retenus, puis la décision de partir.
Certains comportements, en revanche, doivent alerter. Repérez les situations suivantes :
- Présence d’une hypotonie durable (membres peu toniques, faible résistance au mouvement)
- Absence d’envie d’explorer ou de bouger
- Perte de capacités motrices déjà acquises (régression motrice)
- Difficultés associées, notamment pour manipuler les objets ou commencer à parler
- Marche systématique sur la pointe des pieds au-delà de 18 mois
Un retard dans d’autres domaines du développement (langage, sociabilité, compréhension) doit aussi éveiller l’attention. Si l’enfant ne cherche pas à interagir, ne réagit pas aux sollicitations, ou semble détaché, il est préférable de demander un avis médical sans attendre. Être attentif, sans céder à l’inquiétude permanente, permet de détecter des troubles du développement psychomoteur qui, pris tôt, peuvent faire toute la différence.
Conseils concrets pour accompagner son enfant vers ses premiers pas
L’apprentissage de la marche se construit au fil des jours, dans le quotidien. L’idéal ? Permettre à l’enfant de passer du temps au sol, sur une surface sûre, sous l’œil bienveillant de l’adulte. La liberté d’expérimenter est précieuse : du dos au ventre, du quatre-pattes à la position debout, chaque essai contribue au développement moteur. Les pieds nus facilitent la prise de repères sensoriels et favorisent l’équilibre naturel. À la maison, privilégiez des chaussons souples plutôt que des chaussures raides : la sensation proche du sol améliore la proprioception.
Pour stimuler l’envie de bouger, il est judicieux d’aménager l’espace et d’encourager l’exploration :
- Disposez des jouets attractifs à différentes distances pour inviter l’enfant à se déplacer
- Encouragez-le à franchir de petits obstacles, à s’accrocher pour se relever
- Soutenez chaque essai, valorisez les progrès sans pression
La famille joue un rôle clé : chaque enfant progresse à son rythme, et la patience paie toujours. Comparer les enfants n’apporte rien, sinon de la frustration. Mieux vaut respecter le temps d’apprentissage, observer, et accompagner avec confiance.
En cas de doute, le pédiatre reste l’interlocuteur de référence. Selon la situation, il pourra recommander un bilan psychomoteur, des séances de kinésithérapie, ou l’avis d’un psychomotricien, d’un ergothérapeute ou d’un neuropédiatre. Le carnet de santé demeure un allié précieux : noter les avancées, échanger lors des rendez-vous médicaux.
Pour certains enfants, un accompagnement spécifique s’impose. Des exercices simples et ludiques à la maison peuvent compléter la prise en charge. L’essentiel tient dans la relation de confiance avec l’enfant, le lien avec les professionnels et la liberté laissée à chacun d’inventer son propre chemin vers l’équilibre.
Lorsque les premiers pas tardent, le doute s’invite. Mais chaque enfant construit sa marche à sa façon : parfois sur la pointe des pieds, parfois à pas feutrés, mais toujours porté par la curiosité et le soutien de son entourage.